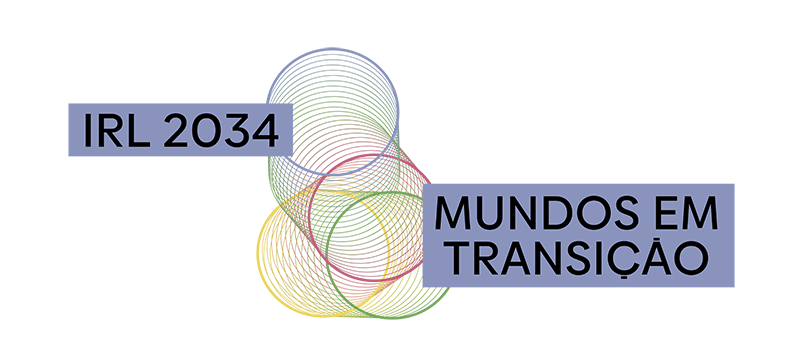
Mutations du droit et de la démocratie
Coordination: Claudia Perrone Moisés et Camila Perruso
La démocratie représentative est en crise. En France, cela se traduit par la montée du Rassemblement national, la participation électorale fluctuante et l’impopularité des exécutifs successifs, parmi les symptômes les plus visibles d’un malaise ambiant ; les structures traditionnelles du gouvernement et du droit public semblent dépassées, manipulées ou voient leur légitimité contestée (durée de l’état d’urgence ; marginalisation des débats parlementaires). La mobilisation de la société civile évolue vers des formes plus violentes, moins organisées (marginalisation des syndicats et des partis politiques traditionnels, mouvement des gilets jaunes, structuration de mouvements organisés tels que les Soulèvements de la terre ou Extinction Rebellion). Au Brésil, comme dans d’autres pays d’Amérique latine et d’Afrique, la démocratie encore récente semble aussi fragilisée (dictature civile-militaire de 1964 à 1985 ; application de mesures d’exception par l’État, progression du crime organisé dans les périphéries délaissées par l’État, violences et zones « grises » de non-droit…). Dans le même temps, dans les deux pays, des expérimentations sont tentées pour revitaliser la démocratie et la rendre plus participative (budgets participatifs, conventions citoyennes…).
Le droit connait également de profondes mutations. Dans un contexte de mondialisation, il n’échappe pas à l’internationalisation. Les circulations de normes et influences mutuelles d’un système juridique à l’autre s’approfondissent. Elles ont lieu aussi bien à l’échelle horizontale (d’un État à l’autre, non pas seulement Nord-Sud, mais Sud-Nord, Nord-Nord, Sud-Sud) et verticale (de l’international au local et vice versa). Les formes juridiques évoluent aussi, avec le développement du droit souple, des pratiques de régulation ou d’auto-régulation, l’influence des logiques managériales (place croissante des chiffres, objectifs et indicateurs…). Dans un monde complexe, l’organisation de l’expertise est également un enjeu fort. Enfin, le rôle des juges et de la justice connait de fortes mutations ; la justice est d’ailleurs pleinement traversée par les grands enjeux contemporains (inégalités, immigration, environnement…).
Ce sont ces évolutions contemporaines que les recherches conduites dans le cadre de l’axe 4 se proposent d’analyser, tout en les resituant pleinement dans leur dimension historique. De ce point de vue, il faut rappeler que les formes concrètes de la « violence » dans la colonisation des terres américaines, dans les procédures politiques et juridiques, ont défini et réglementé le statut de la propriété foncière, entraîné la désintégration des liens communautaires des communautés autochtones, et l’extraction du travail des individus. L’impérialisme a été instrumental dans l’élaboration du droit moderne (y compris du droit international), car c’est dans le cadre de la « rencontre » (conquête) coloniale que les doctrines de base du droit public et du droit privé ont été forgées. La souveraineté ou la propriété n’ont pas été créées en Europe puis simplement transférées, par le biais des empires européens, au monde non européen. Au contraire, la souveraineté et la propriété sont des notions qui ont été mises en place lors des rencontres impériales et structurées de manière à exclure, à déposséder et à priver une large partie du monde non européen.
L’objectif est d’examiner les modes de production du droit, les ambivalences des outils juridiques et leur relation avec les changements politiques et les transformations sociales dans les contextes des différentes transitions dans une perspective comparatiste (France, Brésil, autres pays notamment d’Amérique latine et d’Afrique, droit européen, droit international). De ce point de vue, la collaboration franco-brésilienne dans le cadre de Mondes en transition sera pertinente pour aborder, dans le cadre de l’axe 4, des questions transversales comme les flux et reflux de la démocratie et le tournant autoritaire, les formes de démocratie participative, l’évolution de la citoyenneté et des sentiments d’appartenance nationale, la construction historique des systèmes juridiques et les influences croisées entre eux, en lien avec l’axe 1, la fabrication du droit et des politiques publiques et le rôle des experts qu’ils soient juristes ou non juristes, de l’échelle internationale à l’échelle locale, les formes de contrôle des pouvoirs publics et notamment le contrôle juridictionnel, ou encore la justice transitionnelle.
Les projets pourront aussi porter sur certains domaines ou branches du droit, tels que le droit administratif ou constitutionnel, lieux privilégiés pour comprendre les relations entre le droit et la politique d’une part, et entre le droit et les politiques économiques d’autre part (responsabilité sociale et environnementale des entreprises, digitalisation et intelligence artificielle, fonctionnement des marchés illégaux transnationaux et leurs conséquences sur la violence, la politique et la démocratie, les politiques sociales et particulièrement aux évolutions contemporaines du travail, travail subalterne, précarisation et plateformisation, conséquences de la pandémie et sens du travail). Les recherches s’attacheront également à la protection des peuples, identités et savoirs autochtones et au traitement juridique des discriminations (genre, race, religion, handicap…), en lien avec les axes 2 et 3. Ils réfléchiront par exemple à l’impact des politiques identitaires et de discrimination positive, en passant par la confrontation entre les politiques universalistes et les politiques de promotion de droits spéciaux, ainsi que la recherche d’une compréhension renouvelée des conventions, des représentations et de la sociabilité associées à la race/ethnicité, à la sexualité, au genre, à la sécurité alimentaire ou à l’accès aux soins de santé.
En lien avec l’axe 5, le projet pourrait aussi conduire à repenser l’articulation entre les sphères économique, sociale et environnementale et travailler sur les mutations du droit (et des institutions) pour répondre aux besoins d’une transition écologique juste. Les catégories traditionnelles du droit doivent évoluer (et évoluent) dans le monde, ce qui doit conduire à travailler sous une approche comparative sur les évolutions de notions comme celle de propriété (fonctions sociale et écologique de la propriété, communs, les transformations de l’entreprise …), souveraineté (face aux interdépendances croissantes), responsabilité (limites du schéma classique de la responsabilité juridique et les processus d’expansion auxquels elle est soumise : aux côtés d’une responsabilité punitive ou réparatrice, une responsabilité préventive, agissant par anticipation, les mouvements d’expansion de la responsabilité juridique et de juridicisation de la responsabilité sociétale), la personnalité juridique (des objets de tutelle qui deviennent des sujets de droit). Il est aussi pertinent de s’interroger sur la fonction du procès (procès stratégiques dans le domaine du climat ou fonction mémorielle des procès des crimes de masse…).
Ces différents projets sont susceptibles d’associer l’ensemble des disciplines des SHS. En effet, les thématiques abordées dans le cadre de l’axe 4 nécessitent de combiner des analyses du point de vue interne et externe au droit, seules à même de permettre de comprendre l’évolution des grands systèmes et instruments juridiques, leur mobilisation dans les politiques publiques et la régulation sociale, les limites et obstacles rencontrés, pour éventuellement fournir des pistes pour des transitions plus douces et mieux vécues.
Voir les autres axes du projet :
- Axe 1 — Circulations, mobilités et espaces transnationaux
- Axe 2 — « Faire monde » dans la diversité des langues et cultures
- Axe 3 — Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
- Axe 4 — Mutations du droit et de la démocratie
- Axe 5 — Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
