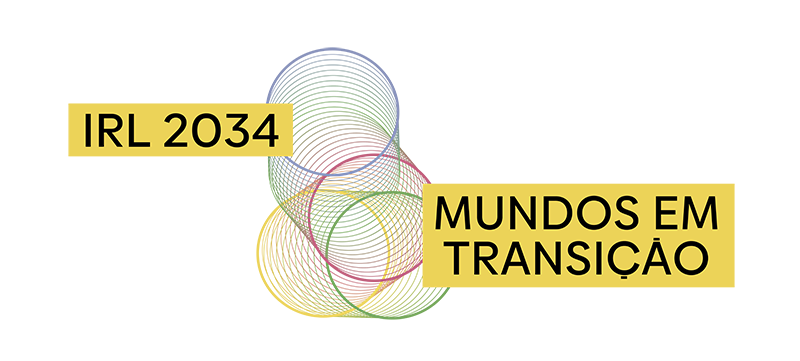
Circulations, mobilités et espaces transnationaux
Coordination : Stefania Capone et Laura Moutinho
Cherchant à dépasser les approches locales ou nationales de la construction des politiques publiques, des systèmes juridiques ou des mouvements artistiques, les recherches conduites dans le cadre de cet axe s’intéresseront aux circulations transnationales dans un sens très large, incluant aussi bien les circulations de personnes qu’elles soient contraintes ou choisies (travailleurs migrants, réfugiés y compris climatiques, mais aussi élites économiques ou intellectuelles, artistes…), que de biens, d’idées, de valeurs, de concepts juridiques, de pratiques religieuses ou culturelles ou encore de données, selon les époques et les circulations qui les caractérisent ou qui en font exception. Elles s’intéresseront à la fois à l’objet de ces circulations, à leurs vecteurs ou supports (transports, routes, réseaux, numérique…), aux freins ou blocages rencontrés (politiques migratoires, frontières, murs, obstacles juridiques…). Les recherches porteront, sans s’y résumer, sur les relations entre le Brésil et la France. En effet, il ne saurait être question d’oublier ou d’invisibiliser des dynamiques circulatoires plus complexes, multi ou transnationales, impliquant d’autres pays d’Europe (le Portugal, en particulier), mais aussi d’Amérique, d’Afrique et d’Asie. S’attachant à mettre en évidence le caractère multidimensionnel des circulations, les recherches pourront bien entendu s’intéresser aussi à d’autres voies ou espaces de circulation, y compris à l’intérieur du Brésil (corridor bi-océanique, exode rural et processus de métropolisation) et au-delà (jusqu’à « l’enquête globale »). La mise en évidence des circulations Sud-Sud ouvre en particulier de nouvelles perspectives spatio-temporelles.
Pour mettre en valeur et qualifier évolutions, transitions et ruptures en la matière, les recherches porteront sur la période contemporaine, mais prendront en compte la profondeur historique, L’unité de l’Amérique portugaise puis du Brésil est une construction progressive qui se déploie tout au long de la période moderne et à l’époque contemporaine. L’élaboration de formes d’organisation politique propres dans un contexte colonial puis d’indépendance, et de formes sociales en grande partie commandées par la question des relations raciales rendent cette mise en perspective indispensable. L’histoire, y compris l’histoire de la philosophie, sont nécessaires à la compréhension des phénomènes contemporains, dont elle permet aussi de restituer toute la complexité. Les travaux contribueront ainsi à l’historicisation de la mondialisation et à une meilleure compréhension des enjeux contemporains des Mondes en transitions (par exemple le rôle des BRICS ou les enjeux de la polarisation politique avec les gauches ayant émergé en Amérique latine après la fin des régimes militaires et, plus récemment, la poussée de l’extrême droite).
Dépassant tout nationalisme méthodologique, les travaux mettront à jour la perméabilité des États-nations, aux frontières labiles, qui sont traversés, voire contournés par de multiples échanges et mobilités. Les circulations peuvent être envisagées dans leurs différentes dimensions, soit matérielles, soit immatérielles, ce qui permet un dialogue avec plusieurs domaines du savoir (géographie, économie, histoire, philosophie, sociologie, littérature, etc.). Du point de vue méthodologique, cet axe permettra un dialogue interdisciplinaire autour de concepts clés pour l’ensemble des SHS : échange, transfert, appropriation, rejet, asymétrie, nation, hégémonie, pouvoir, etc. Elles s’attacheront aussi à prendre la mesure des hégémonies culturelles existantes.
En lien avec l’axe 2, les recherches conduites dans l’axe 1 croiseront nécessairement les questions d’identité et de patrimoine, la réflexion sur les marges et périphéries du projet de nation brésilienne (populations autochtones, afro-descendantes, rapport à l’esclavage, différentes religions, relations interethniques et interraciales, genre, affirmative actions) et la question de la violence. La diplomatie culturelle ou scientifique sera également un objet d’étude pertinent pour analyser les phénomènes circulatoires. Les travaux pourront par exemple s’attacher à identifier les influences croisées entre la France et le Brésil : présence française dans la construction de la nation brésilienne et de la démocratie ou sur la politique de l’enseignement brésilienne (construction des universités, lycées, structuration des disciplines, importations et dons de livres…), promotion de la francophonie, échanges intellectuels ou économiques, rôle des sociétés savantes et des congrès internationaux. Les changements entrainés par les nouvelles technologies, dans le passé (bateaux à vapeur, chemins de fer, boom de la presse, constitution de la sphère publique, première industrialisation et flux migratoires entre l’Europe et les Amériques), comme au présent (digitalisation, intelligence artificielle) devront être pris en compte, ainsi que la manière dont ils sont « mis en politique publique » (en thèmes si différents comme les dynamiques urbaines, l’hospitalité, la xénophobie, la science ouverte ou l’expansion des réseaux criminels transnationaux par exemple, y compris les tentatives de régulation) ou utilisés par les mobilisations citoyennes (par exemple pour les lois du travail, la démocratie, le climat).
Les recherches s’intéresseront aussi aux dialogues entre les savoirs académiques et les savoirs dits « traditionnels », dialogues engagés très différemment en France et au Brésil. De ce point de vue, tout au long des XIXe-XXe siècle, le Brésil a été le théâtre de mouvements idéologiques, politiques et même armés qui ont tenté de résoudre l’impossible équation entre la diversité culturelle et l’unité politique. À chaque fois, l’anthropologie a été convoquée dans les débats politiques et intellectuels, que les prises de parole soient savantes ou militantes. Dans ce cadre, il semble particulièrement important de prêter une attention fine à la généalogie et aux circulations des savoirs anthropologiques dans et hors de la discipline académique, à leur mobilisation dans des cadres politiques, identitaires, religieux, artistiques. Pour cela, les phénomènes d’appropriation, de distanciation et de transformation des pratiques et du savoir anthropologique, par les communautés (amérindiennes, afrodescendantes, etc.) dans leur travail identitaire et leurs revendications, ainsi que les rapports complexes entre savoirs anthropologiques et savoirs autochtones sont particulièrement d’actualité. À cet égard, en lien avec l’axe 2, il semble opportun d’interroger tout particulièrement l’empowerment de ceux qui étaient autrefois définis comme des « objets » de recherche, nommément les « indigènes », les quilombolas, les favelados, les leaders communautaires et religieux qui, au Brésil, sont de plus en plus nombreux à l’université, grâce aux politiques « d’action affirmative ». On pourrait rapprocher cela des nombreux travaux sur l’agency des subalternes, qui ont montré à quel point les soulèvements, révoltes et résistances — y compris violentes — sont anciennes et structurantes dans la société brésilienne.
Quant aux migrations de personnes, les circulations doivent être appréhendées en fonction de différents types de mouvements dépendant des échelles géographiques et temporelles. Si on qualifie les migrations comme des mouvements à longue distance et à long terme, on note que le Brésil est maintenant affecté par des migrations régionales depuis ses voisins (Venezuela, Bolivie), qui influent sur son approche de cette question, mais aussi par des circulations migratoires plus complexes, servant de tremplin vers les États-Unis et l’Europe pour des populations issues du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie ou des Caraïbes. Les flux plus nombreux, arrivés entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe se tarissent, faisant la place, selon les périodes et les routes migratoires, à d’autres groupes, d’autres motivations, d’autres parcours. Si l’on s’intéresse aux mouvements à plus courte distance et sur des intervalles de temps plus courts, la question des mobilités (quotidiennes, saisonnières, de loisir, d’étude ou de travail) doit aussi être prise en compte. Enfin, dans certains domaines, le concept de circulation a permis de mettre en évidence l’absence de rupture entre le départ et l’arrivée, voire des mouvements de va-et-vient qui viennent modifier, mais pas nécessairement détruire les structures sociales. Ces phénomènes doivent être mis en évidence et expliqués. La géographie peut ici apporter la cartographie qui pourrait jouer le rôle de plateforme pour produire des observations objectivées, pouvant ensuite être interprétées par toutes les autres sciences sociales. S’attacher aux temporalités migratoires permet aussi de mieux appréhender les formes migratoires et, surtout, l’idée de « transition » (temporalités longues, courtes, multiples, multigénérationnelles, les retours, les mouvements pendulaires…). Jusqu’où la migration est-elle « transitoire », à partir de quand est-elle « définitive » ?) Qu’est une migration de courte durée (séjours d’artistes, de touristes), de longue durée (exil, insertion durable, enracinement) ? Et comment penser les transitions selon ces différentes temporalités ? Ces questions permettent de croiser la géographie avec une dimension historique plus dense et d’éviter par là un risque de « mosaïque » sans verticalité temporelle historique ni biographique, liée aux parcours individuels et collectifs, ou générationnelle, liée aux temporalités migratoires d’un groupe (ethnique, politique, familial ou professionnel).
Les recherches conduites dans le cadre de l’axe 1 pourraient être valorisées par la constitution de bases de données, publication d’atlas ou encyclopédies (comme le projet d’encyclopédie numérique Sciences et Cultures France-Brésil [1889-1985] ou la plateforme TRACS [pour Transatlantic Cultures. Cultural Histories of the Atlantic World (18th-21st Centuries]) ou le projet Globalcar (ANR-FAPESP). Lieux par excellence de coopération entre sciences humaines et sociales, informatiques et sciences du numérique, elles mobiliseront les outils et supports numériques (projet Hital Bérose, dédié à l’Histoire de l’Anthropologie en Amérique Latine).
Voir les autres axes du projet :
- Axe 1 — Circulations, mobilités et espaces transnationaux
- Axe 2 — « Faire monde » dans la diversité des langues et cultures
- Axe 3 — Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
- Axe 4 — Mutations du droit et de la démocratie
- Axe 5 — Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
