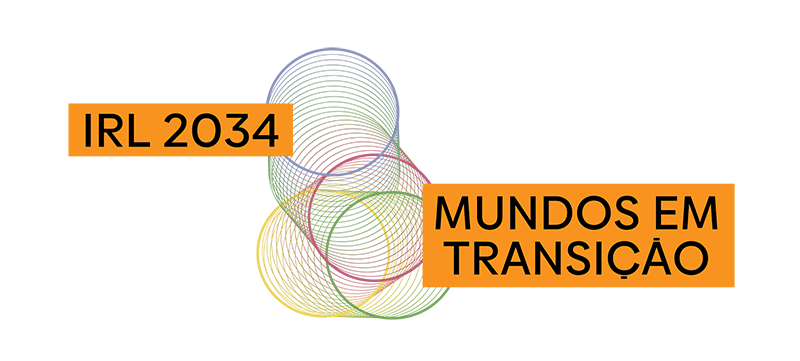
« Faire monde » dans la diversité des identités, langues et cultures
Coordination : Marta Donazzan et Alexandre Yaoh Cobbinah
Depuis 1492, les Amériques occupent une place privilégiée dans l’appréhension de l’altérité telle qu’elle fut pensée en Europe par les philosophes et les missionnaires dans un premier temps, par les savants et anthropologues ensuite. Au Brésil, la présence de populations amérindiennes et de communautés quilombolas issues de l’esclavage, la diversité linguistique, l’existence de clivages ou de différenciations « raciales », sont autant de paramètres qui, depuis l’indépendance, posent des défis considérables à un État-nation qui ne s’accorde pas sur un « roman national » commun.
La revendication des singularités brésiliennes et latino-américaines s’est prolongée jusque dans les controverses internationales avec la remise en cause des politiques indigénistes, les revendications en faveur du multiculturalisme et la montée en puissance d’une approche déconstructionniste, qui récuse les catégories de pensées telles qu’elles ont été façonnées en Europe ou Amérique du Nord. Depuis le tournant du XXIe siècle, l’essor des anthropologies autochtones et des politiques publiques (comme les « ações afirmativas » dans les universités brésiliennes) est sans précédent et bouscule considérablement les pratiques et discours, en modifiant les canons méthodologiques et éthiques de la construction des savoirs ethnographiques et en interrogeant sur les conditions de production du discours anthropologique dans un dialogue direct avec la société. Cela permet d’interroger, en retour, les façons de pratiquer les sciences humaines et sociales en Europe, en pensant les relations France-Brésil dans un cadre plus large, dans un réseau d’influences, d’échanges, d’emprunts qui met en connexion un ensemble d’autres éléments qui dépassent les relations binaires entre ces deux pays. De même, le dialogue intense entre l’Afrique et le Brésil, et plus largement les pays latino-américains, dans la formation des cultures nationales demande d’introduire une dimension résolument comparatiste qui s’avère aujourd’hui incontournable pour comprendre les dynamiques contemporaines en mettant en valeur les relations Sud-Sud.
La question de la diversité linguistique est aussi au cœur de la difficulté à parvenir à « faire monde » dans le respect de la diversité des identités et des cultures. Alors que presque la moitié des 7000 langues pratiquées aujourd’hui dans le monde est menacée de disparition à l’horizon 2100, nombre d’entre elles étant orales et/ou peu ou pas décrites, la perte de la diversité soulève l’enjeu de la sauvegarde des langues minoritaires et régionales, au Brésil, en France et dans le monde. La documentation linguistique pose de défis méthodologiques communs à l’anthropologie et à de nombreuses autres disciplines des SHS ; la linguistique théorique, qui se nourrit de données de terrain, participe aussi de ces préoccupations et, en même temps, permet de répondre à ce défi par son objet de recherche, l’étude du langage. La linguistique contemporaine se demande en effet comment concilier la remarquable diversité des langues avec l’uniformité des bases cognitives et neuronales qui sous-tendent notre capacité à les comprendre et à les parler en tant qu’êtres humains. Relever ce défi suppose de comprendre les sources et les limites de la diversité. Il serait intéressant de ce point de vue de développer des travaux de type expérimental. Moins de 1% des langues du monde sont testées par des protocoles expérimentaux, et la richesse linguistique du Brésil ouvre ici un large champ. La variation linguistique est-elle illimitée et aléatoire, ou bien limitée et contrainte et ainsi prédictible ? Comment articuler invariants typologiques et universaux linguistiques avec l’étendue de la variation attestée ? Comment démêler les différents facteurs linguistiques et extralinguistiques impliqués dans la diversification des langues ? L’existence même d’une linguistique générale dépend, dans une large mesure, de l’identification d’un tel noyau d’invariants, mais ces questions concernent indirectement de nombreuses autres disciplines, telles que l’anthropologie et les sciences cognitives. Aussi, les connaissances issues des études formelles sur l’acquisition du langage nous donnent des outils pour comprendre les procédures d’apprentissage d’une langue seconde, ce qui permet de répondre à un enjeu éducatif et culturel majeur dans les contextes de plurilinguisme qui caractérisent de manière croissante, de deux côtés de l’Atlantique, les sociétés contemporaines.
La diversité culturelle et artistique est composée d’agents, d’institutions et de mouvements qui s’expriment dans différents espaces géographiques, croisant objets, savoirs, pratiques et traditions. Dans un monde marqué par la numérisation, les images mettent en tension cette diversité, apportant de nouveaux défis aux archives et à leur diffusion. Il sera ainsi intéressant d’examiner la diversité du langage dans sa dimension visuelle, en tenant compte de divers formats, supports et médias tout au long de l’histoire, de la peinture à la gravure, de la photographie à l’audiovisuel, etc. Les images possèdent leurs propres moyens d’expression, qui ne peuvent pas être réduits au simple rôle d’illustration du langage verbal. On peut évoquer une culture visuelle croisée entre le Brésil et la France, une iconosphère où des représentations réciproques se connectent et se confrontent.
Face aux revendications de reconnaissance et de protection de la diversité des identités et des cultures, notamment autochtones ou minoritaires, le droit et les politiques publiques sont saisis par l’ensemble de ces questions, mais les politiques de préservation se heurtent à de nombreux obstacles.
Sur le plan méthodologique, le contexte pluridisciplinaire de Mondes en transition offrira un terreau propice au développement de projets associant notamment anthropologie, sociologie, histoire, géographie, philosophie, linguistique et sciences cognitives, mais aussi droit et science politique. Les projets de recherche qui pourraient s’épanouir au sein de Mondes en transition pourraient tenter d’ancrer la critique post-coloniale, certes importante, dans un terrain historique et contextuel, sur la base d’une perspective situationnelle qui devrait, selon nous, guider la recherche dans l’axe 2. En lien avec l’axe 1, ces projets aideront à penser la généalogie de la fabrique des identités contemporaines et, plus généralement, de la mondialisation culturelle dont l’espace atlantique est, sans doute, l’un des plus intéressants laboratoires, en permettant de décrypter les circulations des savoirs entre différents espaces culturels et linguistiques, mais aussi entre la communauté académique et les publics non spécialistes. L’idée de « faire monde » à partir de la diversité culturelle et linguistique requiert la prise en compte des transits et des circulations de pratiques, d’agents et de savoirs, ce qui met en relation étroite les recherches menées dans l’axe 2 avec celles menées dans l’axe 1. En outre, les recherches de l’axe 2 doivent se confronter à la destruction des mondes et à la manière dont les transitions se réalisent par la réappropriation de langues, d’histoires et d’expériences, qui revêtent souvent un caractère politique de revendication d’identités, de territoires et de droits. La considération du problème de la destruction de mondes (langues, cultures, etc.) touche la question écologique et environnementale, qui intéresse aussi aux recherches menées dans l’axe 2, en dialogue avec celles de l’axe 5.
Par ailleurs, les projets conduits comporteront une forte dimension de documentation, passée et présente, intégrant les nouveaux modes de production et d’interprétation des collections d’objets et d’enregistrements sonores et audiovisuels en particulier, mais pas seulement dans les contextes autochtones. Des collaborations intéressantes pourraient être tissées ici en particulier, mais pas seulement, entre linguistes et anthropologues, y compris en envisageant la création de « stations de recherche » partagées, pensées comme des espaces où développer des projets de documentation transdisciplinaires, des programmes de formation au terrain pour les jeunes chercheurs, mais aussi des programmes d’éducation et d’accès aux outils de la recherche qui puissent pleinement profiter aux communautés. Des projets collaboratifs avec des musées pourraient naitre dans le cadre de Mondes en transition, notamment s’agissant de la relation entre les peuples autochtones et les institutions de mémoire au Brésil et en France.
Voir les autres axes du projet :
- Axe 1 — Circulations, mobilités et espaces transnationaux
- Axe 2 — « Faire monde » dans la diversité des langues et cultures
- Axe 3 — Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
- Axe 4 — Mutations du droit et de la démocratie
- Axe 5 — Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
